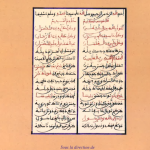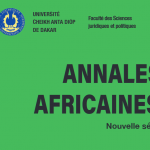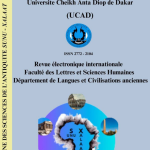 Dr Moussa SAMBA
Dr Moussa SAMBA
moussa.samba@ucad.edu.sn
Dr Mor DIEYE
mor.dieye@ucad.edu.sn
Dr Aminata KANE
aminata18.kane@ucad.edu.sn
EBAD-Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Résumé : Cet article tente d’étudier les similitudes qui existeraient entre la psychanalyse et
l’archivistique surtout en ce qui concerne la gestion et la conservation des souvenirs et des
traces de la mémoire. L’objectif ici est, en effet, de voir les liens qu’on pourrait établir entre les
fonctions de la psychanalyse et celles de l’archivistique. La fonction des archives est de mettre
en place des outils et instruments pour la gestion, la conservation et la pérennisation des
documents d’archives produits ou reçus dans le cadre des activités des personnes physiques ou
morales. La psychanalyse étant considérée comme la science de l’inconscient, sa fonction
principale est d’aider une personne à mieux vivre grâce à une cure psychanalytique ; cette cure
passe par l’exploration de son inconscient pour essayer de résoudre les conflits qui remontent
à son enfance et qui pèsent sur son existence. À l’instar d’un fonds d’archives, ces conflits sont
enfuis dans son inconscient comme un « fonds de faits et de souvenirs ». Au travers d’un
cheminement à la fois empirique et réflexif, nous essayerons d’établir des passerelles relevant
soit, d’une relation homothétique, soit d’une similitude accidentelle entre psychanalyse et
l’archivistique.